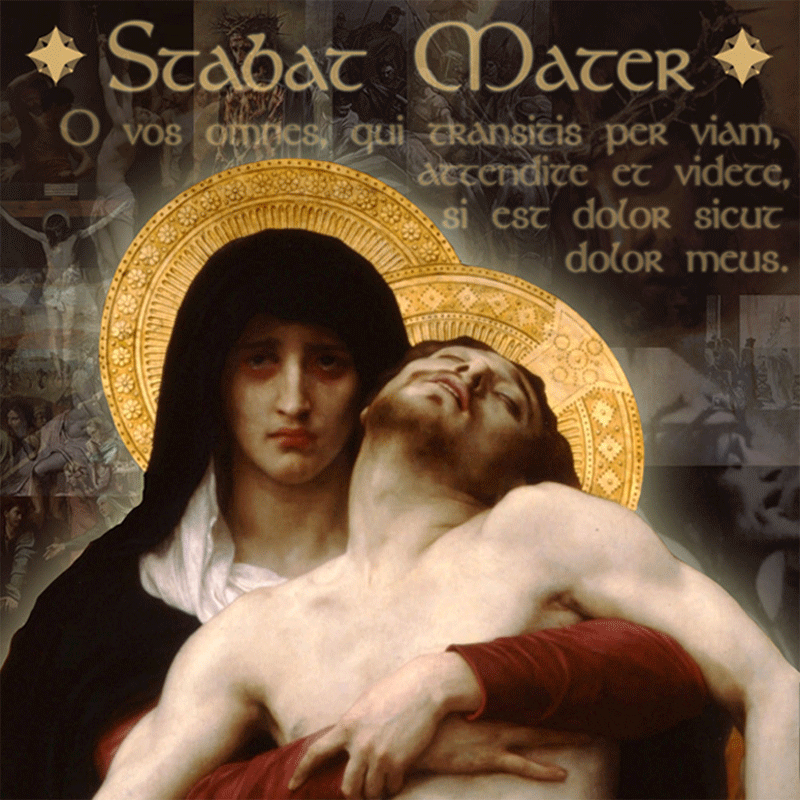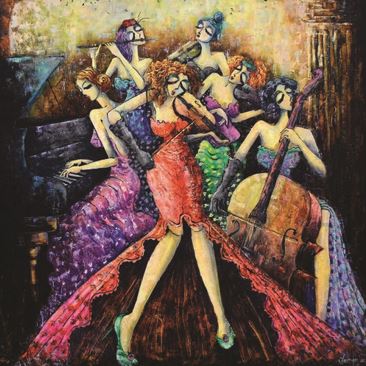Stabat Mater de Luigi Boccherini
Chapelle du Fort de Bellegarde, LE PERTHUS
Prix adherent(e) 26+: €12
Prix non-adherent(e) 26+: €15
Moins de 16 ans: gratuit
Prix adulte: Enfants - €5
Moins de 16 ans: gratuit
Prix non-adherent(e) 26+: €15
Moins de 16 ans: gratuit
Prix adulte: Enfants - €5
Moins de 16 ans: gratuit
Capacité:
Parking à proximité: Oui
Accessible aux handicapés:
Parking handicapés:
Organisé par Musiques & Voix en Pays Catalans
Parking à proximité: Oui
Accessible aux handicapés:
Parking handicapés:
Organisé par Musiques & Voix en Pays Catalans
Partagez / Compartir / Share
Veuillez ne pas changer de langue sur cette page /
Si us plau, no canvieu d'idioma en aquesta pàgina /
Please do not change the language on this page
Si us plau, no canvieu d'idioma en aquesta pàgina /
Please do not change the language on this page



 sam 21-Sep-2019 17:00 - 18:30
sam 21-Sep-2019 17:00 - 18:30